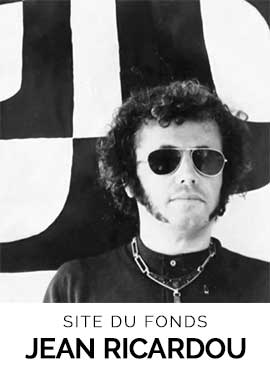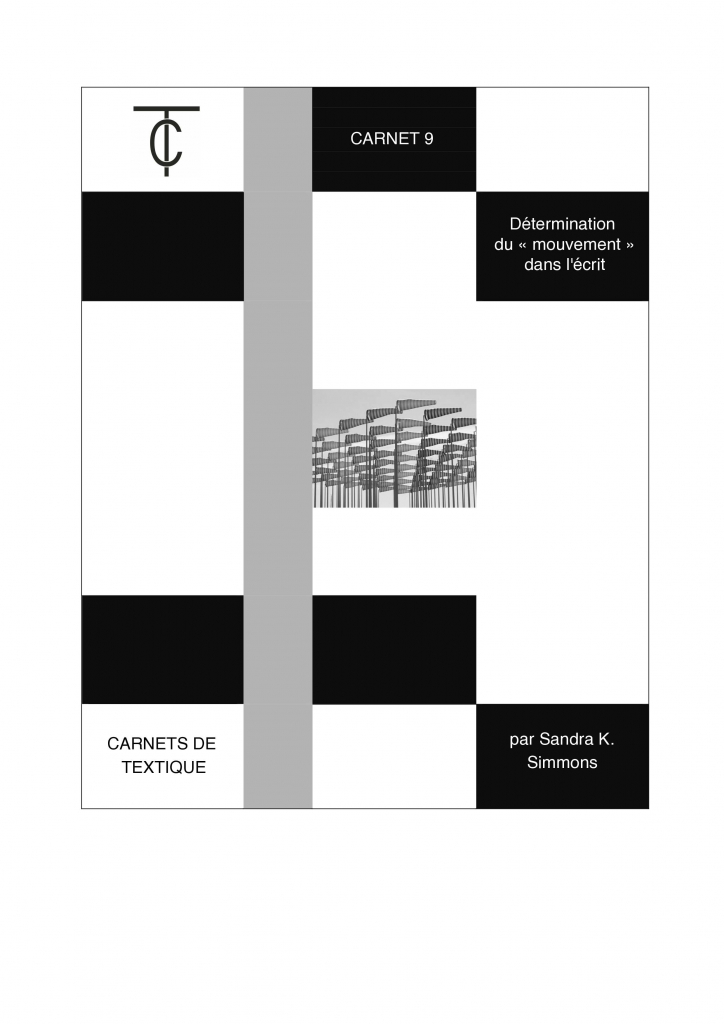Ce carnet offre une contribution présentée en 2011, au vingt-troisième Semtext (Séminaire annuel de textique), et retravaillée pour la session de 2017. L’étude, répondant à une invitation, n’était pas astreinte à employer la méthode ni les outils conceptuels de la textique. Cependant deux motifs ont conduit à la retenir pour figurer dans les Carnets : d’une part elle s’appuie sur la définition très large de l’écrit, tel que la discipline l’a établie, c’est-à-dire tout champ que déterminent des structures fondées sur un effet différentiel ; d’autre part elle s’efforce, même si sa démarche apparaît comme plus énumérative et descriptive que systématique, de satisfaire à la tâche formulée par Jean Ricardou dans la fiche du Cortext (Cercle Ouvert de Recherche en TEXTique) intégrée au Carnet de Textique n’ 8, c’est-à-dire explorer, en amorçant leur classification, les diverses modalités de mouvement repérables le cas échéant dans un écrit.
Une telle tentative a l’intérêt d’ouvrir sur un domaine complexe, jusqu’alors peu abordé dans le cadre de la textique, l’existence d’écrits qui apparaissent comme investis par un mouvement, qu’il soit effectif ou non, exigeant à ce titre l’élaboration d’une problématique nouvelle par rapport aux écrits dont les éléments sont fixes. Du même coup elle oblige à prendre en compte la dimension temporelle, dont l’observation d’écrits à l’allure immuable permet de faire abstraction.
En tout état de cause, l’examen des occurrences et l’effort de classement qui l’accompagne ne prétendent pas fournir un inventaire exhaustif ni une répartition totalement achevée, mais s’applique à inventorier bon nombre de cas en les distribuant selon des catégories plus générales, susceptibles d’éclairer la recherche ultérieure. C’est donc d’un travail préparatoire qu’il s’agit, mais qui se montre fidèle à l’approche globale de la textique et qui peut servir d’ébauche à l’exploration d’un domaine de l’écrit que la théorie n’a pas encore traité.
Encore faut-il, comme il a été remarqué à propos du Carnet n° 8, faire preuve de prudence dans l’enquête et ne pas s’engager dans une conceptualisation hasardeuse qui laisserait de côté certains aspects décisifs des phénomènes et, dès lors, ne réussirait pas à prendre en compte, palier par palier, l’ensemble des cas envisageables.
Son extériorité relative par rapport à l’édifice de la théorie textique met le travail proposé à l’abri de cette objection rédhibitoire. C’est pourquoi il s’autorise à sérier des catégories de phénomènes sans avoir à bâtir d’abord une matrice conceptuelle hiérarchisée, capable de tous les englober. Il s’agit en somme d’un inventaire empirique raisonné, qui a le mérite d’éclairer la diversité des occurrences et d’effectuer un tri, en manifestant certains ressorts parmi les plus notables.
L’ensemble de l’examen est organisé sur la base d’une distinction entre deux grandes catégories, elles-mêmes subdivisées en deux : ou bien le mouvement discernable est effectif, soit qu’il réponde à un fonctionnement intrinsèque, soit qu’il résulte d’un agent extérieur, ou bien il est suggéré par l’écrit, soit qu’il repose sur l’ajout par la lecture d’un élément virtuel, soit qu’il relève d’un leurre perceptuel. Que le second type de phénomènes soit tributaire d’une impression produite sur le cerveau des observateurs justifie, dans le titre de la contribution, le recours aux guillemets pour le vocable « mouvement ».
En outre l’accent est mis par l’étude sur la perspective d’un réglage, susceptible d’organiser les divers aspects du mouvement repérable, qu’il s’agisse des facteurs, qui déterminent une mobilité, actuelle ou virtuelle, dans l’écrit, ou des caractéristiques temporelles du mouvement, par exemple sa périodicité.
Ainsi la réflexion s’oriente vers la recherche d’agencements pour les structures en cause, débouchant sur l’éventualité d’en renforcer la cohérence. Bref, conformément à un principe décisif de la textique, la lecture est conçue comme une étape dans un processus d’écriture : en l’occurrence elle engage sur la voie d’une potentielle récriture, moteur d’une évolution dont la dynamique serait à prendre en compte comme un élargissement du rôle dévolu au mouvement dans l’écrit, dont il tendrait alors à constituer un ressort intrinsèque.