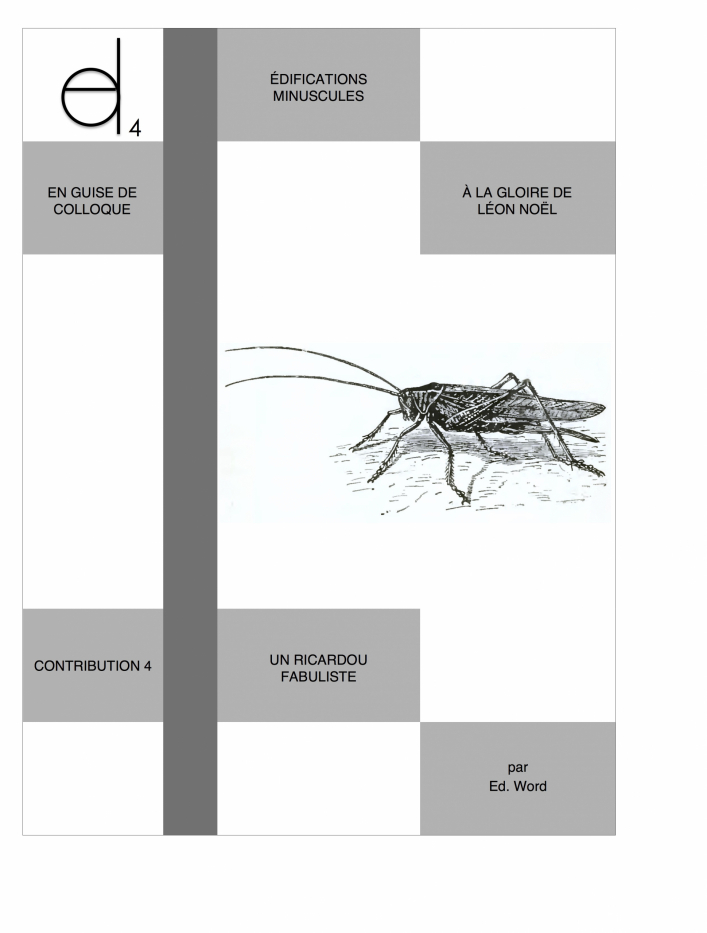“Je ne suis pas tout à fait celui que vous croyez.”
Jean Ricardou, Révélations minuscules, en guise de préface, à la gloire de Jean Paulhan, passim (in Révolutions minuscules, seconde édition, Les Impressions nouvelles, 1988).
18 septembre 1974
Pendant la guerre, on devait subir le fascisme, l’abus d’autorité des Allemands, mais on ne pouvait rien leur dire! Ils avaient remplacé nos panneaux de signalisation par de gros panneaux jaunes avec les lettres noires en caractères gothiques, je les vois encore: Kommandantur…
Mais un jour j’étais chez moi lorsque j’ai entendu un gros bruit dehors. Je suis sorti et j’ai vu ma chatte Miki faisant tranquillement sa toilette comme d’habitude au milieu de la rue. J’ai couru l’attraper et j’y ai vu la traction avant des nazis, ces assassins, à l’arrêt juste devant: ils avaient freiné violemment pour éviter d’écraser un chat!
9 février 1980
Entre 5-6 et 12 ans, j’étais anorexique, c’est-à-dire à la maison je ne mangeais presque rien, il fallait me forcer. Ça me dégoûtait. C’était pendant la guerre, et il n’y avait presque rien à manger, tu ne peux pas imaginer. Mais comme il n’y avait rien à la maison, on m’a inscrit à la cantine, et là je mangeais normalement, comme tous les autres enfants, alors que ce qu’il y avait était vraiment horrible. Ils n’avaient rien, c’était une sorte de soupe. À la maison non plus il n’y avait rien, mais c’était cuisiné avec beaucoup de talent. Le docteur avait prédit, à un an près, quand ça s’arrêterait: à la puberté. C’était vraiment un rapport familial: à la maison, je ne mangeais pas. L’anorexie vient des rapports avec la mère: les anorexiques sont des enfants qu’on couve trop, on les étouffe. Alors ils refusent. C’est un refus de ce qui vient de la mère.
Mon frère, par contre, qui avait 10 ans de plus que moi, avait toujours faim, et vers la fin de la guerre, lors du repas, quand il avait mangé le peu qu’il y avait pour lui et en réclamait encore, il m’arrivait de rompre mon petit morceau de pain, qui était tout ce que je mangeais et je le mangeais très lentement pour que ça dure jusqu’à la fin du repas, puis je lui en donnais la moitié. Il le dévorait sans rien dire.
Vers la fin de la guerre, quand on n’avait plus rien du tout, c’était l’été, et nous sommes allés chez des cousins qui habitaient la campagne. On portait chacun un gros pardessus que ma mère avait préparé. On est rentrés par le train en plein cagnard tous avec notre lourd manteau, la doublure et les manches bourrées de saucisses, de jambon… Mon père voulait tout manger tout de suite, mais ma mère a réussi à nous rationner assez pour que ça dure un petit peu.
décembre 2004
Il repart à Cannes comme tous les ans à Noël et en été. Et pourtant il ne reste rien de ce qu’il y a connu autrefois: – C’est comme Los Angeles. – Je remarque que les choses telles qu’on les a connues dans l’enfance nous semblent “les vraies choses”, même les marchands, dont les suivants nous semblent des usurpateurs. Or, ce qu’il y eut alors n’est que ce qu’il y eut à une époque, ni plus vraie ni moins vraie qu’une autre, mais cela ne nous empêche pas d’imaginer que “c’était mieux avant”.
Mais pour moi, ça n’était pas mieux avant. Enfant, je pleurais tout le temps, car je n’étais pas d’une grande santé. Ma mère ne m’a pas porté dans de bonnes conditions, chez moi ce n’était pas très sain, il n’y avait pas de bonnes conditions psychologiques non plus: beaucoup de violence, tout le monde se disputait toujours, et puis j’ai connu les privations de la guerre: on subissait les bombardements, le nazisme, la répression, la pauvreté, la faim, les crimes de guerre, innombrables…
Tu ne peux pas imaginer mon désespoir, à 7 ans, lorsqu’on éventra la place devant ma maison pour y creuser des tranchées. Et puis, l’été, il était interdit d’aller à la mer, bien qu’elle fût à deux pas de la maison, car le bord de mer était réquisitionné par l’occupant, et la plage minée.
Nous avions un voisin tapissier, un vieux juif polonais que j’aimais beaucoup. J’allais discuter avec lui et jouer aux dames. Puis un jour quelqu’un l’a dénoncé et il a été déporté. Il n’est jamais revenu. Après la guerre sa veuve, qui n’avait plus rien, est revenue voir ma mère, car, disait-elle, son mari, prévoyant le pire, avait caché tout son argent sous le parquet, et il devait y avoir un magot qui lui suffirait pour le reste de ses jours. Alors ma mère, à qui on avait confié les clefs, l’a faite entrer dans son ancien logement, où elle a soulevé une lame du parquet et sorti des billets à pleines poignées. Elle était si contente. Mais ensuite ma mère a regardé: c’était des vieux billets qui n’avaient plus cours. – Donc qui ne valaient plus rien? – Donc ils ne valaient plus rien.
Tu vois, moi, enfant, je n’ai jamais connu ce sentiment d’un monde de possibles qui s’ouvrira lorsqu’on sera grand, car avec la guerre, la faim, puis la crainte que, si venait la libération, il y aurait des combats où l’on risquerait de mourir dans un bombardement… non, vraiment, pour moi l’enfance n’était pas un âge d’espoir.
– Et pourtant, tu repars à Cannes retrouver ton enfance? – Mon enfance, c’est dans mon cœur.
(extraits de Les mots dits – Jean Ricardou au fil des phrases, de Noëlle Riçœur, inédit)